Le régiment de Royal-Roussillon est fondé le 25 mai 1657, par le cardinal de Mazarin, à qui il appartient. Ainsi, il est d'abord connu sous le nom de Catalan-Mazarin. Le régiment passe l'année à Perpignan où il a été formé. À la mort du cardinal en 1661, Louis XIV, héritier universel de Mazarin, le renomme Royal-Catalan. Il prend définitivement le nom de Royal Roussillon en 1667. Le régiment recrute ses premiers engagés dans les provinces de Roussillon et de Catalogne.
Le Royal-Roussillon participe à plusieurs sièges, batailles ou guerres, un peu partout sur le territoire européen. Certains des soldats du second bataillon, venus au Canada lors de la guerre de Sept Ans, participent entre autres, aux campagnes suivantes:
Bataille de Parme 29 juin 1734, campagne d'Italie
Siège de Pizzighetone ou Piziquiton septembre 1734, campagne d'Italie
Bataille de Guastalla ou Guestelle 19 septembre 1734, campagne d'Italie
Corse 1739-1741
Rheinweiler 4 septembre 1743, succession d'Autriche
Siège de Fribourg 1744, succession d'Autriche
Col de l'Assiette 19 juillet 1747, succession d'Autriche
En 1746, le régiment quitte les Pays-Bas pour aller défendre la Provence contre l'invasion italienne. Une ordonnance du Roi du 25 octobre entérine la formation d'un second bataillon. Ce n'était pas la première fois qu'on doublait les effectifs du Royal Roussillon. Un second bataillon avait été mis sur pied en 1701 mais avait été licencié en 1715. Ce même second bataillon est envoyé au Canada en mars 1756, en compagnie de celui de La Sarre, non sans avoir été presque entièrement reconstitué à même le premier.
Le second bataillon rentre en France à l'automne 1760. Les soldats, qui ne sont plus en état de combattre, entrent aux Invalides en 1761. Les autres sont envoyés de La Rochelle vers la vallée du Rhône où ils seront appelés à surveiller la frontière franco-italienne. Une quarantaine de Lorrains feront le voyage de retour. De ce nombre, une bonne trentaine demeurera encore quelque temps dans l'Armée. Les invalides, pour une grande part, bénéficieront d'un nouveau programme de pension, instauré par le Roi. Grâce à cela, ils pourront retourner vivre dans leur coin de pays, près des leurs, où séjourner dans l'institution hospitalière de leur choix.


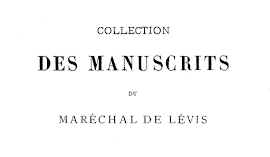
,%20A.%20d'%20Auriac..png)